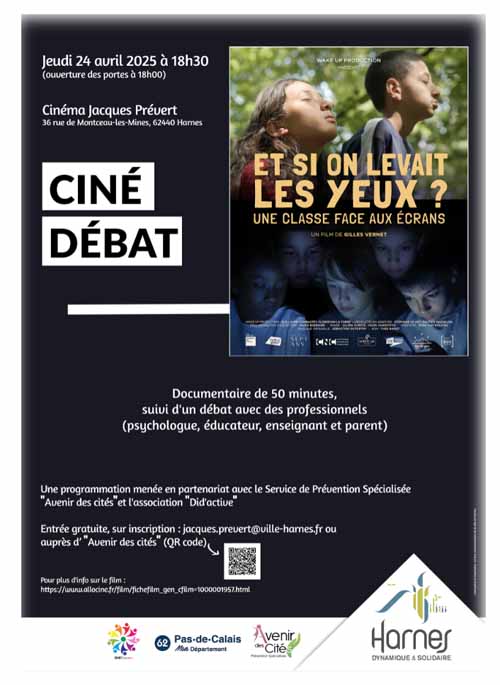
Des associations réclament un moratoire avant la construction de (très) gros data centers en France
De gigantesques data centers pourraient bientôt se multiplier sur le sol français, en vertu de la loi « simplification de la vie économique » visant à faciliter leur implantation. Une évolution législative critiquée par plusieurs associations. Trois questions pour en comprendre les enjeux.
« Je peux vous le dire, nous irons vite, très vite. » En plein sommet de l’IA à Paris, début février, Macron avait promis de multiplier les data centers sur le territoire afin de donner une chance à la France de rejoindre la « course à l’IA ». C’est tout l’objectif de l’article 15 du projet de loi « simplification de la vie économique » débattu à l’Assemblée nationale du 8 au 15 avril, qui vise à « accélérer certaines procédures » relatives à l’installation de ces infrastructures considérées, dans ce texte, comme des « projets d’intérêt national majeur ».
Une telle évolution législative qui permettrait de contourner les réglementations environnementales et de se passer de débats publics, dénonce La Quadrature du net. Épaulée entre autres par le collectif marseillais Le Nuage était sous nos pieds, l’association de défense des libertés numériques appelle les élus à soutenir un moratoire de deux ans sur la construction des plus gros data centers en France.
Mobilisées contre ce projet de loi aux côtés de l’association Data4Good et la coopérative Commown, ainsi que de La Quadrature du Net au sein de la coalition Hiatus, Lise Breteau, avocate en droit du numérique et membre de l’association GreenIT (qui défend un numérique durable), et Max Rivière, militante au sein du collectif marseillais Le Nuage était sous nos pieds, nous ont exposé ses enjeux.
Pourquoi cette loi pourrait-elle aggraver les impacts sociaux et environnementaux des data centers en France ?
Lise Breteau : Dans l’étude d’impact de la loi, il est question de projets avec une emprise au sol comprise entre 30 et 50 hectares (soit jusqu’à 71 terrains de foot, ndlr). Ce ne sont même plus des data centers, ce sont carrément des villes – des « data villes ». On est dans le gigantisme.
Ensuite, ce qui nous pose problème, c’est qu’il n’y a aucune distinction, aucun fléchage sur tel ou tel type d’infrastructure ou d’usage : le dispositif sera ouvert à tout type de data center, que ce soit dans un objectif de transition numérique, de transition écologique, ou de souveraineté nationale. On nous annonce ainsi des objectifs qui sont censés être d’intérêt général. Mais la transition numérique ne relève pas de l’intérêt général : c’est un phénomène économique. Par ailleurs, en termes de transition environnementale ou de souveraineté nationale, comme il n’y a pas de cadrage dans le projet de loi, tous les projets peuvent être admis à bénéficier de ce dispositif.
Max Rivière : L’état actuel des choses est déjà catastrophique, et cette loi ne va faire que démultiplier le phénomène. Les data centers consomment en effet énormément de ressources électriques et d’eau (voir notre article sur l’impact écologique des data centers en France, ndlr). Par ailleurs, les garde-fous étaient déjà très faibles. Il y a plein de techniques pour passer sous les radars. Par exemple, les gros data centers peuvent être construits en plusieurs « morceaux », comme le déplorent les habitants opposés au projet de data center d’Amazon à Wissous par exemple.
Cela permet de tomber sous un seuil au-dessous duquel ces infrastructures sont moins réglementées. Les industriels profitent également des nombreux flous juridiques et réglementaires pour faire de l’optimisation fiscale, comme Orange a pu le faire dans l’Eure. Cette loi va juste ancrer ces pratiques, ou du moins les encourager.
Autre élément préoccupant : avec cette loi, le statut de projet d’intérêt national majeur va retirer les data center du champ de compétence des collectivités territoriales et remettre les décisions dans les mains du gouvernement. Comme l’État est favorable à l’implantation des data centers, les collectivités n’auront plus de marge de manœuvre. À Marseille, ce conflit est déjà très présent puisque la majorité des data centers sont construits dans l’enceinte du Grand Port Maritime qui est un établissement public géré par l’État, qui échappe donc à la ville de Marseille. Celle-ci n’était pas très contente de voir les data centers se multiplier, notamment parce que c’est du foncier qui lui échappe, et en plus ces centres de données ne créent pratiquement aucun emploi. Demain, l’exemple de Marseille pourrait devenir beaucoup plus commun.
Ce projet de loi, vous l’avez dit, vise notamment à asseoir la « souveraineté nationale » en matière de numérique et d’IA. En quoi cet argument est-il trompeur ?
Lise Breteau : Il y a une fausse croyance qui veut qu’à partir du moment où un data center serait installé en France, on aurait de la puissance de calcul française et une souveraineté sur le data center en question. Malheureusement, beaucoup de parlementaires se font avoir par ce discours. En réalité, peu importe l’endroit où est situé le data center : ce qui compte, c’est qui le contrôle.
Le règlement général sur la protection des données (RGPD), lui, raisonne correctement : il ne va pas chercher à savoir où sont localisées les données pour savoir comment elles sont régies. Ce qui compte, c’est où est situé le responsable de traitement des données.
Or concernant les data centers, on sait très bien qu’un certain nombre d’acteurs extra-européens ont eux-mêmes l’obligation de donner accès aux données qu’ils contrôlent dans leurs data centers – où qu’ils soient – à leur gouvernement. C’est notamment le cas aux États-Unis, avec le Cloud Act.
Le problème, c’est que le projet de loi du gouvernement a été très mal rédigé de ce point de vue puisqu’il n’y avait rien sur la localisation des acteurs qui contrôlent les données. En commission spéciale, un amendement a été ajouté pour essayer d’aligner le dispositif sur le RGPD, avec l’objectif de faire bénéficier du régime dérogatoire uniquement les acteurs issus de pays qui protègent les données aussi bien que le RGPD. On ne sait pas si cela va être maintenu en séance publique cette semaine.
Max Rivière : On le voit avec toutes les annonces de centres de données en France, et avec les acteurs qui sont déjà en place : il s’agit essentiellement d’entreprises étasuniennes. Construire des data centers sur le sol français sous un principe de « souveraineté numérique » est donc une illusion. C’est même l’inverse qui se produit, avec un accroissement de la dépendance aux GAFAM.
Cette dépendance se manifeste aussi à travers les partenariats public-privé signés avec les GAFAM, comme Microsoft dans la région Sud par exemple, où les agents territoriaux sont remplacés par des bots (à travers ce partenariat, la région explique vouloir favoriser « l’adoption de l’IA par [ses] agents », ndlr).
Vous appelez à un moratoire de deux ans, le temps d’instaurer un processus démocratique. À quoi ce dernier pourrait-il ressembler concrètement ? Quelles alternatives pourraient en émerger ?
Lise Breteau : Chez GreenIT, nous interrogeons beaucoup la « course à l’IA ». On n’a pas forcément développé des solutions alternatives. En revanche, on veut qu’il y ait un débat et que l’on puisse s’interroger sur les bénéfices réels de l’IA. On nous vend beaucoup l’IA sur la recherche pour le climat, ou pour comprendre le langage des baleines, et c’est formidable. Mais je ne suis pas sûre que les méga-usines d’IA que l’on va construire avec le projet de loi « simplification de la vie économique » vont servir à cela.
La situation rappelle un peu la 5G, qui avait été déployée sans qu’il y ait le moindre débat, ni pour les entreprises, ni pour les citoyens. Pourtant, à l’époque, le Haut conseil pour le climat avait sévèrement critiqué cette technologie, en disant qu’il y aurait dû y avoir un débat démocratique avant d’imposer un déploiement généralisé qui aurait pu être circonscrit aux besoins de l’industrie. Les gens n’utilisent en effet pas autant de data que ce qu’on leur offre aujourd’hui. Avec l’IA, on est en train de reproduire exactement la même chose.
L’intelligence artificielle s’inscrit dans tout un écosystème de pratiques et d’usages qui vont à l’encontre de tout ce qu’il faudrait faire pour que le numérique soit un peu plus durable. Les consommateurs sont incités à acheter des smartphones boostés à l’IA, alors que l’on s’acharne depuis des années à dire qu’il faut garder nos appareils le plus longtemps possible (car l’impact écologique intervient principalement au moment de la fabrication d’appareils neufs). Selon moi, l’IA devrait être limitée à des champs comme la médecine et la recherche sur le climat : on ne devrait pas généraliser cette technologie.
Max Rivière : Le moratoire nous paraît important parce qu’il permettrait déjà de faire une pause. Les data center sont des infrastructures complexes, en constante évolution, il y a une grande méconnaissance des pouvoirs publics et de la population sur le sujet. Les industriels en profitent très largement, et entretiennent à dessein un vocabulaire très flou, tout en étant très peu transparents. Ils disent donc un peu ce qu’ils veulent. Le Guardian a révélé que les émissions des data centers étaient 662 % plus élevées que les chiffres annoncés !
Se poser la question des alternatives est compliqué parce que le débat est tellement accaparé par le gigantisme que l’on a du mal à imaginer autre chose et les alternatives sont mal connues et mal documentées. De la même façon qu’aujourd’hui, on pense qu’Internet, c’est ça, alors qu’il y a mille autres façons de faire sans passer par d’immenses plateformes capitalistes collectant des centaines de milliards de données, comme les réseaux peer-to-peer, décentralisés. De nombreux collectifs, associations, organisations, proposent des alternatives locales, low tech et décentralisées, qui ne reposent pas sur des besoins de stockages de données à grande échelle. Il existe aussi des data centers de petite taille, municipaux ou publics, qui répondent à une logique de décentralisation.
usbeketrica.com