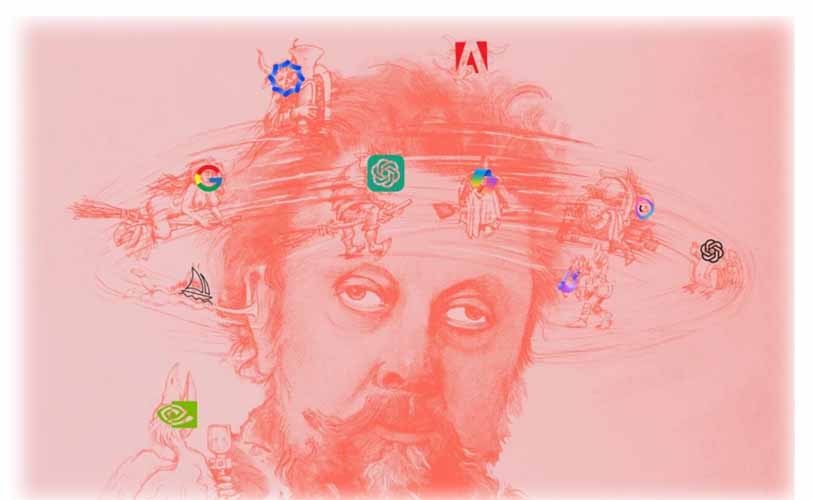
L’EHS n’est pas une maladie psychosomatique !
Une unité de l’INSERM vient de démontrer que, derrière les déclarations des personnes se considérant électrosensibles, se trouve bel et bien une réalité moléculaire. Un pas de géant pour la reconnaissance de l’électrosensibilité.
L’électrosensibilité n’est pas un problème psychosomatique : il y a bien une réalité moléculaire derrière les déclarations des personnes expliquant souffrir des ondes électromagnétiques. C’est ce que vient de démontrer l’unité U1296 de l’Inserm (1) à travers une étude financée par l’Anses et publiée dans la revue à comité de lecture International journal of molecular sciences (2). Cette unité est la seule, en France, à être entièrement consacrée à la radiobiologie généraliste – autrement dit à l’étude des effets des radiations ionisantes, quels que soient les scénarios d’exposition : militaires, civils, professionnels, accidentels, médicaux, environnementaux… Ainsi, elle travaille aussi bien avec le Service de santé des armées qu’avec le Centre national des études spatiales (Cnes), ou les organismes de santé publique, étudiant par exemple l’effet de la radiothérapie sur les individus. Elle est, surtout, à l’origine d’une découverte essentielle dans le domaine, à savoir l’importance de la protéine ATM dans la réponse individuelle aux radiations ionisantes.
Radiorésistants et radiosensibles
La protéine ATM, quèsaco ? Accrochez-vous deux minutes, si vous pigez ça, vous
comprendrez tout le reste… Chacune de nos cellules comporte, en son noyau, 3 mètres d’ADN double-brin. Il arrive que ces brins d’ADN se cassent, notamment après une irradiation : la décomposition de l’eau contenue dans la cellule produit alors de l’eau oxygénée, qui a la particularité de casser l’ADN. C’est à ce moment là qu’intervient la protéine ATM : au repos dans le cytoplasme sous la forme d’un dimère (assemblage de 2 protéines), ATM se divise en deux monomères sous l’effet de l’eau oxygénée, et donc en proportion du stress : la cellule est son propre dosimètre. Les ATM monomériques se dirigent alors dans le noyau, signalent les cassures de l’ADN et activent la réparation. C’est rudement bien foutu, on est d’accord. Sauf que l’efficacité de ces protéines ATM n’est pas uniforme à tous et toutes. Trois groupes d’individus peuvent être identifiés au sein de la population. Le groupe I, qui concerne au moins les trois quarts de la population, est constitué des « radiorésistants ». Chez eux, ATM fait parfaitement son boulot, toutes les cassures sont reconnues, réparées, impec. Le groupe III concerne une partie très minoritaire de la population. Chez ces personnes, généralement des enfants atteints de maladies rares, ATM n’agit pas car il est muté. Il n’y a donc pas de réparation et la mort intervient bien souvent avant l’âge adulte. Enfin, le groupe II, représentant 5 à 20 % de la population, est constitué de personnes « radiosensibles ». Chez elles, les monomères d’ATM entrent en compétition avec des protéines anormalement surexprimées dans le cytoplasme, appelées X, (X, car elles peuvent changer d’un individu à un autre). Leur présence va limiter le flux d’ATM vers le noyau de la cellule, et toutes les cassures de l’ADN ne seront donc pas détectées. Celles-ci peuvent alors être soit mal réparées (prédisposition au cancer), soit tolérées, déclenchant une mort lente de la cellule (prédisposition aux maladies dégénératives), soit non réparées (toxicité cellulaire). Ces personnes peuvent donc montrer une certaine prédisposition aux effets secondaires de la radiothérapie – une irradiation aux rayons X. L’étude qui a révélé tout ça, publiée en 2016, a rebattu les cartes de ce domaine de recherches, et du même coup fait la renommée internationale de l’Unité de Nicolas Foray : « C’était la première fois qu’on observait une relation entre les données cliniques et les données moléculaires », précise ce dernier. L’une des applications très concrètes de ces découvertes est de contrôler l’usage des radiothérapies. Pour cela, avant de faire subir un tel traitement à un patient, une analyse de biopsie permet de dire s’il appartient au groupe I – feu vert – ou au groupe II – mieux vaut trouver un autre traitement ou le modifier. Pour le savoir, l’Unité de Nicolas Foray observe la réaction de cellules prélevées sur ce patient. Car, rappelle le chercheur, les cellules présentent un avantage fondamental : « elles ne mentent jamais ! »
Une cohorte de 26 électrosensibles
Lorsque son laboratoire s’est lancé dans l’étude de l’électrosensibilité, il a donc décidé d’appliquer strictement ce même protocole, aussi robuste qu’éprouvé, sur des cellules de personnes se déclarant électrosensibles. Même s’il y a à priori peu de points communs entre électrosensibilité et radiosensibilité, le but était de savoir si les électrosensibles appartiennent à un groupe unique de radiosensibilité et si leur protéine ATM est fonctionnelle. Une cohorte de 26 donneurs volontaires, nommée « cohorte Demeter », a été constituée grâce à l’aide de l’association Priartem/électrosensibles de France. Des cellules de peau ont été prélevées sur ces individus, puis analysées, avant et après avoir été exposées à des rayons X ou à de l’eau oxygénée. Bingo ! Sur ces 26 donneurs, 26 sont détectés radiosensibles ! Cela signifie que, si tous les radiosensibles ne sont pas électrosensibles, tous les électrosensibles pourraient en revanche être radiosensibles. « En termes de reconnaissance, c’est un point énorme pour les électrosensibles, car ça les fait rentrer dans un groupe moléculaire pathologique déjà défini et très documenté en radiobiologie », insiste Nicolas Foray. Les découvertes vont encore plus loin. Il avait été décidé, en effet, d’intégrer un questionnaire à cette étude. « Mais dès le départ, nous avons construit le mur de Berlin entre les réponses au questionnaire et les études biologiques, rapporte le chercheur, car on pouvait nous accuser de falsifier les réponses aux questionnaires en fonction des résultats obtenus en biologie. » Les questionnaires ont ainsi été placés dans des enveloppes doublement scellées, elles-mêmes étant enfermées dans un coffre, afin que ces résultats n’influencent pas les observations biologiques.
Au moins deux électrosensibilités
L’analyse très poussée de ces données déclaratives a notamment permis de faire ressortir deux sortes d’électrosensibilité. Dans un premier groupe, les personnes interrogées expriment des douleurs permanentes fortes, mais qui augmentent peu en présence d’ondes : ils seront appelés les HBLR – High Background Low Responsive, ou fort bruit de fond et faiblement répondant. Un autre groupe, à l’inverse, souffre peu lorsqu’il est faiblement exposé mais beaucoup dès que le niveau d’ondes augmente – ce sont les LBHR, Low Background Highly responsive. Or, de l’autre côté du « mur de Berlin », qu’ont observé les radiobiologistes ?
Chez certains individus de la cohorte Demeter, les cassures d’ADN spontanées – sans que la cellule soit irradiée – sont nombreuses, suggérant un comportement HBLR. Chez d’autres, les cassures spontanées sont peu nombreuses, suggérant un comportement LBHR. Les résultats du questionnaire semblent donc se retrouver dans l’observation des cellules. « Nous avons eu 65 % d’identité [de correspondance, Ndlr], ce qui est très significatif pour une notion aussi vague que l’est encore l’électrosensibilité », observe Nicolas Foray. Et les risques liés à ces formes d’électrosensibilité sont bien réels, eux aussi : principalement un risque de vieillissement prématuré des cellules et de maladies neurodégénératives chez les HBLR, principalement un risque de cancer chez les LBHR. La démonstration étant désormais faite que l’électrosensibilité est une réelle pathologie et correspond à une définition moléculaire (donc objective), Nicolas Foray entend poursuivre les études. « La prochaine étape logique, c’est d’exposer les cellules à des ondes électromagnétiques », explique-t-il, afin de cerner, plus spécifiquement, les signes cliniques, voire d’envisager des traitements préventifs : « Aujourd’hui, on peut faire disparaître certains symptômes d’une personne radiosensible. On doit pouvoir trouver pour l’électrosensibilité. »
Nicolas Bérard, journaliste à l’Âge de faire
** **
Cet article est paru dans le numéro d’octobre du mensuel. Il fait parti d’un dossier de 7 pages ayant pour titre : le numérique, notre meilleur ennemi ?
** **
1- L’Institut national de la santé et de la recherche médicale est un établissement public.
2- Skin Fibroblasts from Individuals Self-Diagnosed as Electrosensitive Reveal Two Distinct
Subsets with Delayed Nucleoshuttling of the ATM Protein in Common.