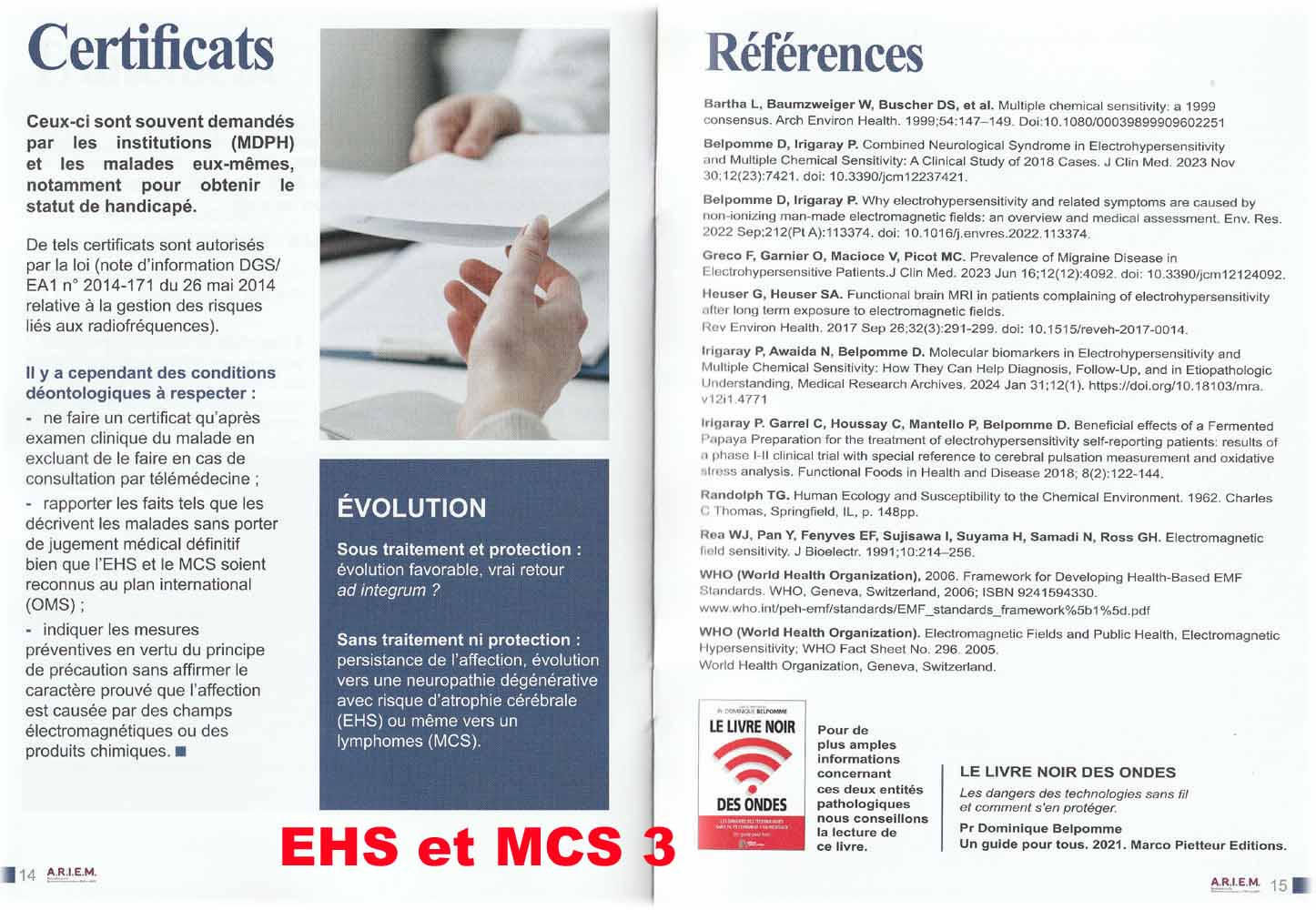
Peut-il y en avoir à l’université ?
En réaction à la tribune du sociologue Manuel Cervera-Marzal consacrée aux risques et aux usages plus prometteurs provoqués par l’IA à l’université, trois enseignants-chercheurs en sociologie à l’Université d’Évry Paris-Saclay jugent nécessaire d’avoir une approche beaucoup plus critique, « en faisant de l’université un lieu de résistance aux évolutions sociales, économiques, technologiques ».
** **
La tribune du sociologue Manuel Cervera-Marzal publiée dans Le Monde le 29 août et consacrée aux bouleversements provoqués par l’IA à l’université commençait bien. Elle rappelait fort justement le désarroi dans lequel sont plongés les collègues universitaires depuis quelques mois face au déferlement de travaux réalisés par des étudiants en ayant recours à l’IA. Sauf que son auteur voit également des « usages plus prometteurs » de cette technologie, appelant ainsi ses collègues à ne pas l’interdire au prétexte que cela serait d’emblée « inapplicable » mais plutôt à s’y adapter en transformant leurs modalités d’enseignement et d’évaluation.
Il ne s’agit évidemment pas « d’ériger des interdits inapplicables » comme le craint l’auteur de cette tribune, et comme cela est souvent mal posé à propos des enjeux environnementaux avec la notion discutable d’« écologie punitive ». Au contraire, l’objectif est d’encourager la population à questionner la place de l’IA dans la société, ses effets et le cas échéant, de décider de s’y opposer collectivement. Il est indéniable que l’IA fait dorénavant partie de notre époque. Faut-il pour autant automatiquement accepter tout ce qui en découle, comme anesthésiés au regard de toutes les facettes du « progrès technologique » ? Il est ainsi bien étrange de la part d’un sociologue de considérer qu’il est des évolutions sociales et technologiques qu’il ne serait pas possible de contester, comme si celles-ci étaient inéluctables et naturelles – en dirait-on tout autant des inégalités de genres, de races ou de classes ?
L’impasse des « bons et mauvais usages » de l’IA
L’idée de voir dans l’IA des « usages prometteurs » est tout aussi surprenante, comme s’il pouvait y avoir un bon et mauvais usage d’une technologie qui ne relève en rien d’un outil, ainsi que l’écrit improprement l’auteur au sujet de l’IA, mais bien davantage d’une machine – et en l’occurrence d’un système technologique complexe. Un tel système dépasse largement l’usage individuel que peut faire une personne d’un outil se contentant de prolonger la manipulation humaine – sur la distinction outil-machine, nous renvoyons aux travaux de l’historien américain Lewis Mumford [1] ou encore du chercheur en sciences de gestion Jacques Girin [2]. Nombre d’auteurs comme Alain Gras ont démenti cette idée reçue qu’il existerait de « bons et mauvais usages » de techniques sophistiquées, considérées indépendamment de leurs contextes économiques, sociaux et politiques, à l’image du bon et mauvais usage que nous pourrions faire d’un couteau ou d’un marteau [3]. Or, en la matière, il ne saurait y avoir de continuité, ni de comparaison possible entre un marteau et l’IA.
Lorsque Manuel Cervera-Marzal repère durant ses cours des usages intéressants de l’IA, pour « générer un contre-argument » ou « comme point de départ pour discuter un texte », on se demande qui sont ces étudiants qui parviennent à résister à la tentation de faire faire à l’IA le résumé qu’ils devaient initialement réaliser. Car l’IA est d’abord conçue comme une technologie qui se substitue à l’analyse. Il est par conséquent difficile de l’utiliser autrement. Ainsi, que signifierait « faire un usage différent » du smartphone dont la finalité est de pouvoir communiquer à tout moment, et de densifier chaque instant où l’on se retrouve seul et éloigné de ses connaissances ? Quel sens pourrait avoir une utilisation réduite ou mesurée de ce moyen de communication, contraire aux objectifs qui ont guidé sa fabrication et commercialisation ? Il parait inconcevable d’envisager par le seul changement d’usage un autre rapport au temps et à l’espace que celui intrinsèquement contenu dans ces techniques hypercomplexes.
Face à l’IA, repenser la critique de la technique
Que dire également de l’argument rebattu selon lequel, par le passé, « chaque grande innovation technique a suscité une sorte de panique morale », argument qui sert de cheval de Troie pour empêcher toute réflexion critique menée à propos de l’innovation technologique. Plutôt que d’avoir recours de façon inadaptée à une notion à la mode employée pour désigner les réactions conservatrices à l’égard de tous autres sujets (l’écologie, le féminisme, l’antiracisme, etc.), les historiens des techniques parlent eux de « résistances » et de « contestations populaires » face à des mutations techniques et industrielles qui ont bel et bien bouleversé les modes de vies et de travail de populations entières – en générant des pollutions, en multipliant les accidents du travail, en supprimant des pans entiers d’activités, etc.
Loin d’avoir été exagérées, ou rabaissées au rang de peurs infondées, il semblerait que lorsque l’on relit des auteurs tels que Marx, Heidegger, Arendt, Anders, Illich ou encore Ellul, ces contestations et ces analyses critiques furent annonciatrices des dégâts provoqués par ces transformations technologiques aujourd’hui et que souvent, elles ont même été dépassées par l’ampleur des catastrophes actuelles.
In fine, cette tribune est symptomatique des difficultés de la gauche à penser la critique de la technique aujourd’hui, et ce indissociablement d’une critique du capitalisme. Pour la gauche, au nom de la lutte pour l’égalité face à la technique, il faut « sauter dans le train du progrès », l’enjeu étant surtout de faire de l’IA un « bien commun » qui n’appartiendrait plus aux puissances privées. Et si la question environnementale de l’IA est à juste titre évoquée par le chercheur en sociologie, c’est pour promouvoir un « usage raisonné » de cette technologie et en limiter les « usages superflus », idée qui entre en contradiction avec le développement exponentiel de l’IA sur lequel reposent les usages alternatifs qu’entrevoit le chercheur.
Comme en conclut Manuel Cervera-Marzal, l’université a bien pour vocation l’émancipation. Sauf qu’à la différence de l’auteur, nous considérons qu’une telle émancipation est incompatible avec le formatage des étudiants aux réalités techniques de leur temps. Elle doit au contraire leur donner les moyens de penser de manière critique ces dernières en faisant de l’université un lieu de résistance aux évolutions sociales, économiques, technologiques, etc., ainsi que l’appelaient de leurs vœux des penseurs critiques tels que Jacques Derrida [4] et Noam Chomsky [5].
Signataires :
Fabrice Colomb ; Gaëtan Flocco et Mélanie Guyonvarch, enseignants-chercheurs en sociologie à l’Université d’Évry Paris-Saclay
** **
Notes
[1] Lewis Mumford, Technique autoritaire et technique démocratique, Saint-Michel-de-Vax, La Lenteur, 2021.
[2] Jacques Girin, « Les machines de gestion », in Michel Berry, Le rôle des outils de gestion dans l’évolution des systèmes sociaux complexes, Rapport pour le Ministère de la Recherche et de la Technologie, Centre de recherche en gestion de l’École polytechnique, 1983.
[3] Alain Gras, Fragilité de la puissance. Se libérer de l’emprise technologique, Paris, Fayard, 2003.
[4] Jacques Derrida, L’université sans condition, Paris, Galilée, 2001.
[5] Noam Chomsky, Réflexions sur l’université. Suivies d’un entretien inédit, Paris, Raisons d’Agir, 2010.